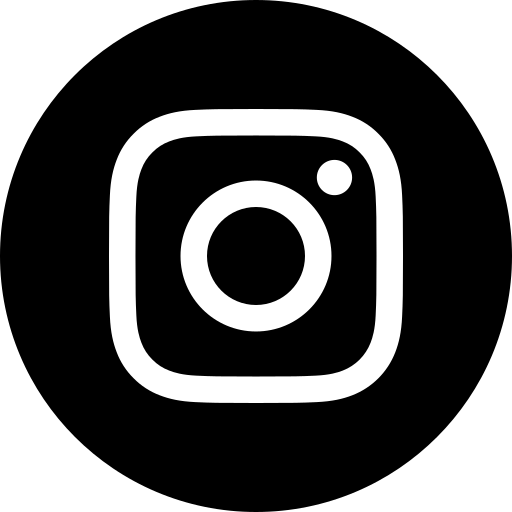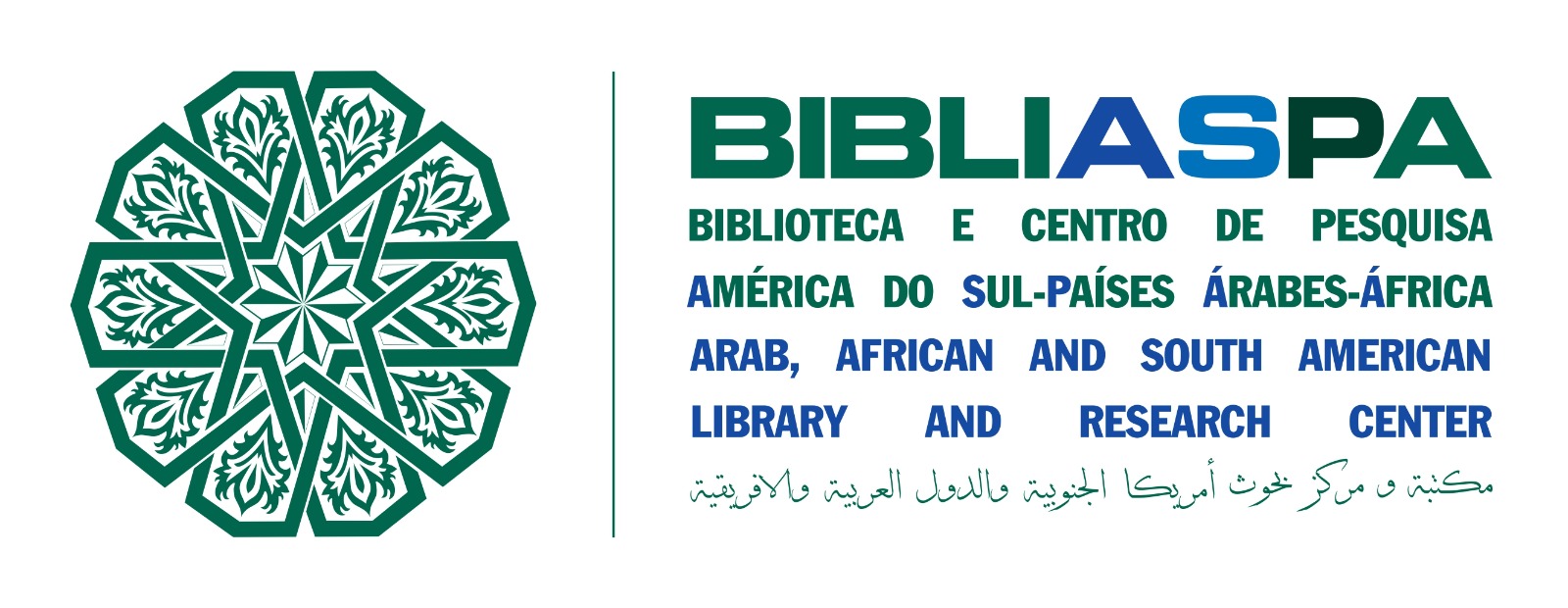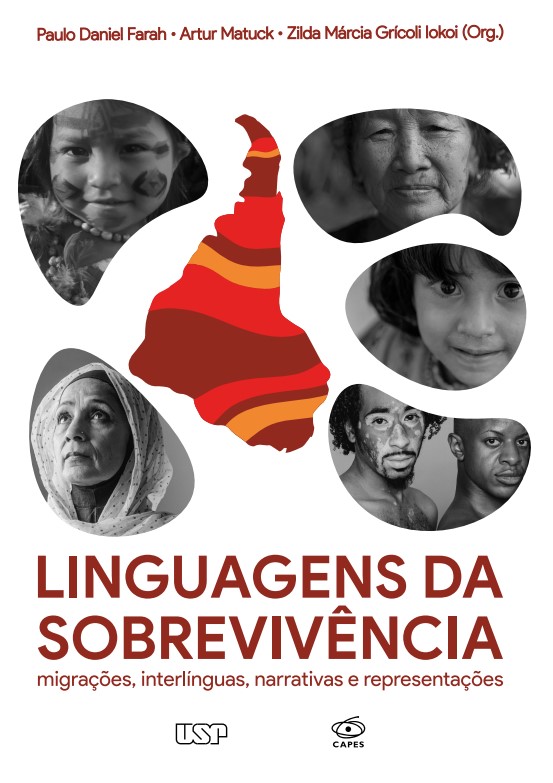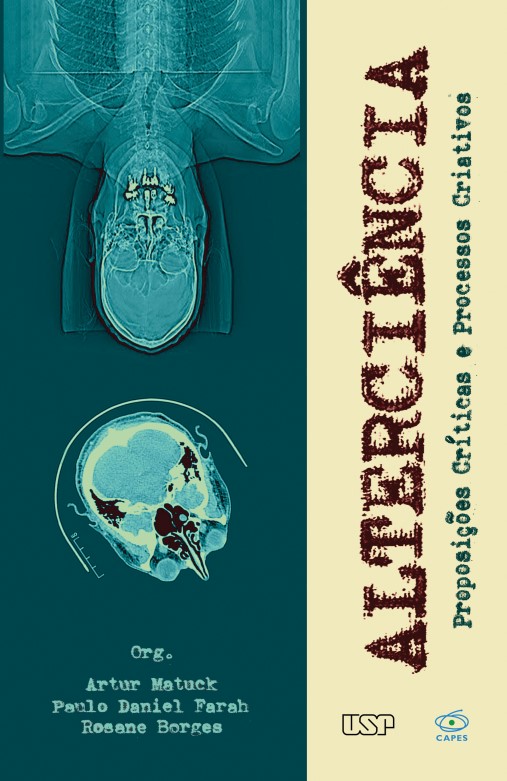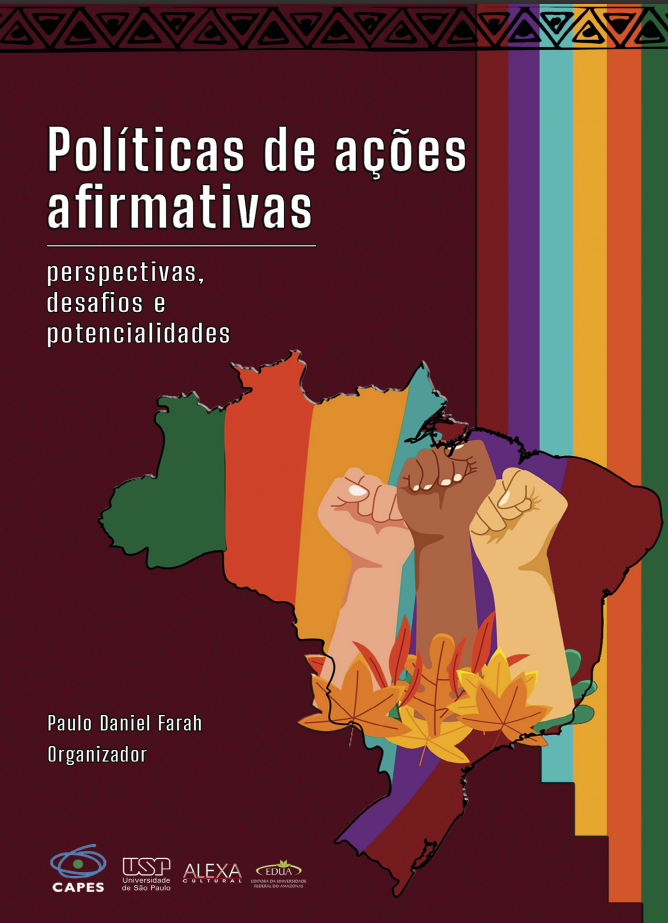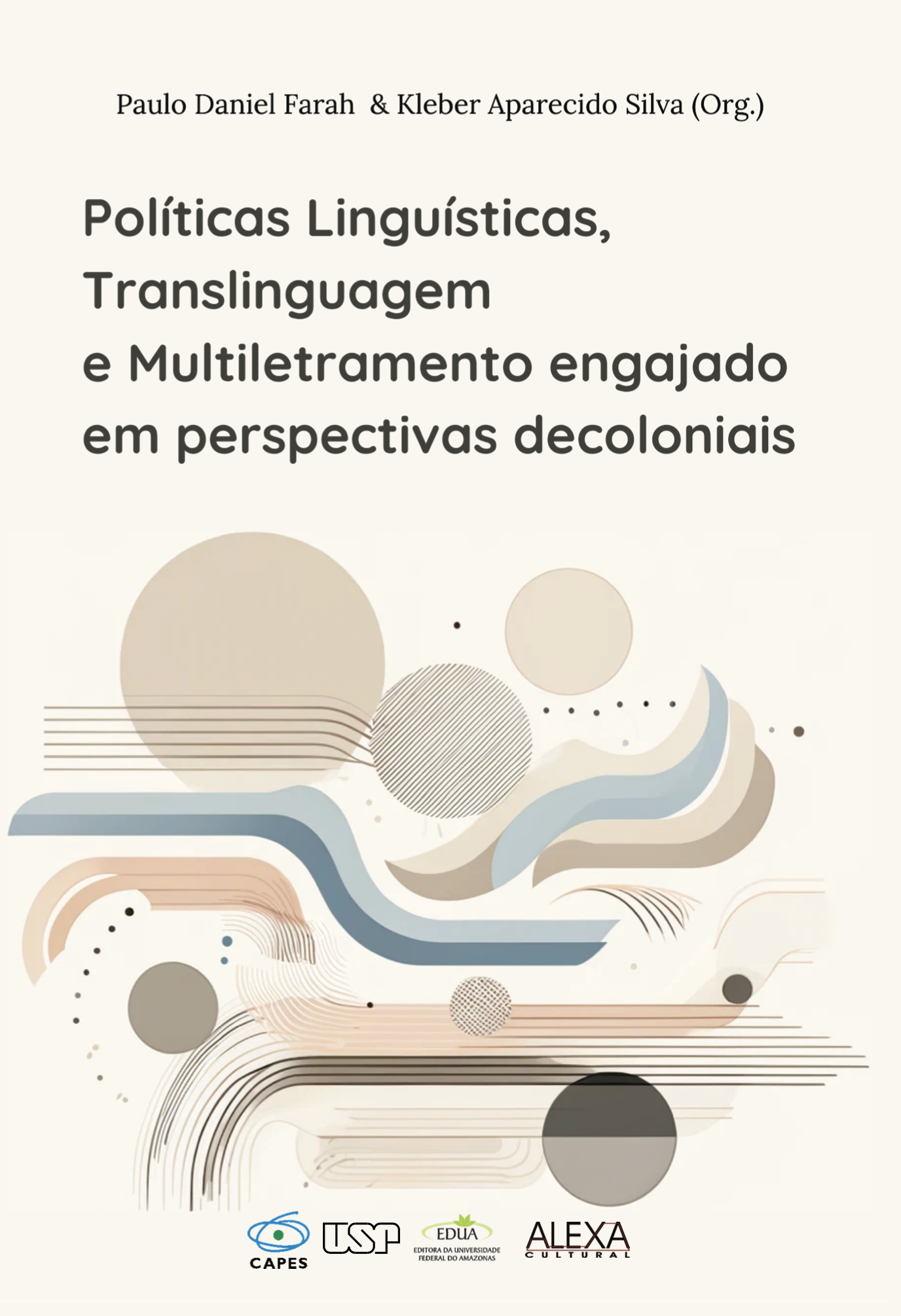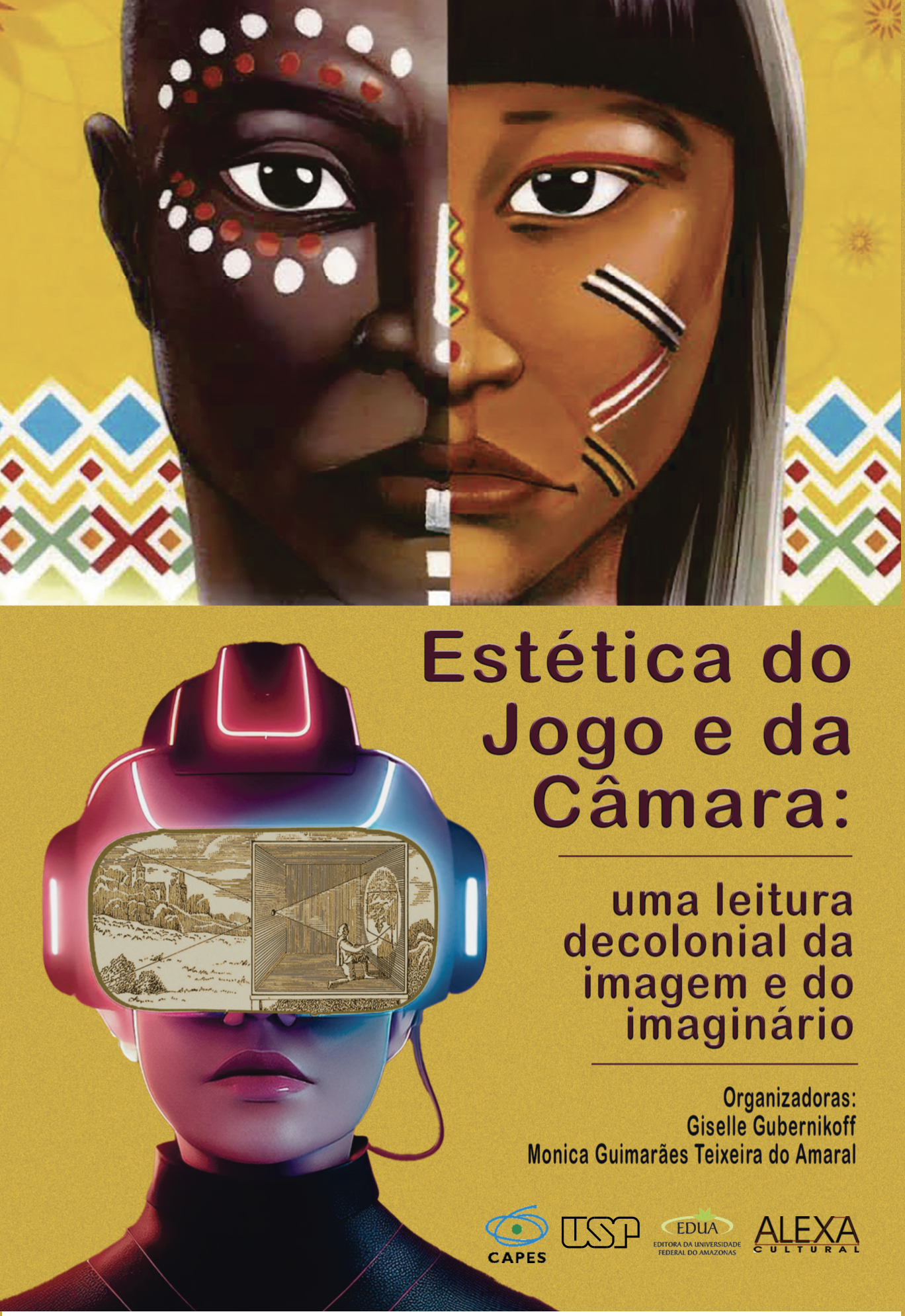Thème et préoccupation interdisciplinaire
Le programme interdisciplinaire d'études supérieures en sciences humaines, droits et autres légitimités est une initiative d'enseignants-chercheurs de différents domaines de connaissances - tels que la sociologie, les communications, l'histoire, la littérature, l'anthropologie, la psychologie, la linguistique, la géographie, le droit et l'environnement - qui se consacrent à l'étude des questions liées à la diversité culturelle et à ses implications. L'effort commun pour un programme interdisciplinaire naît du mécontentement face aux résultats partiels et aux limites des approches disciplinaires. La Faculté de Philosophie, Lettres et Sciences Humaines est l'unité chargée de la gestion administrative du programme, à laquelle participent également les enseignants permanents des unités suivantes : École Supérieure d'Agronomie Luiz de Queiroz (ESALQ), École de Communication et des Arts (ECA) et Institut de Psychologie (IP).
Le programme fait partie du Domaine de connaissances interdisciplinaires – Sous-domaine social et humanitaire (Capes) avec un domaine de concentration unique appelé Sciences humaines, droits et autres légitimités et rassemble ceux qui s'intéressent aux études interdisciplinaires qui proposent des travaux axés sur l'observation. . qui convergent avec le holistique.
Cette proposition vise à répondre aux défis de la coexistence contemporaine entre des groupes aux caractéristiques variées qui ont généré des manifestations d'antagonismes qui se traduisent par des distances marquées par des segmentations hiérarchiques en classes sociales, races/ethnies, genres, orientations sexuelles et dimensions religieuses. En raison du manque de compréhension et de lignages politiques capables de promouvoir la coexistence démocratique, des conflits sont imposés, alimentant une violence qui s'exprime de différentes manières. C’est la configuration de « l’étrange ». Figure anormale et réceptacle des atrocités commises à différents niveaux.
Dans le cas brésilien, ces manifestations se retrouvent dans des conflits contemporains qui s'expriment, par exemple, dans la controverse sur les politiques positives ou compensatoires, notamment les quotas. Un autre exemple concerne la démarcation des territoires indigènes, qui montre la tension révélée dans les conflits aigus, dans les suicides de segments tribaux ; Il s'agit de conflits qui impliquent les secteurs gouvernementaux, l'appareil judiciaire, les institutions religieuses, les médias et les producteurs ruraux qui ont infiltré des zones restreintes. Des questions de cette ampleur renvoient aux politiques d'exclusion/inclusion, qui touchent directement les habitants ruraux et urbains, dont les protagonistes sont regroupés en associations. Il y a aussi la situation des réfugiés, des apatrides et des immigrés dans un monde marqué par un nombre record de déplacements forcés et la montée de la xénophobie.
Il existe donc un risque sérieux qu'une mentalité fondée sur des sentiments et des comportements intolérants et antidémocratiques se généralise de plus en plus - précisément dans un pays qui s'est toujours targué, parfois à juste titre, parfois moins, d'être tolérant et capable d'accommoder ou de surmonter les conflits par la cordialité. Parallèlement au discrédit croissant auquel est confronté l’État, qui n’assure pas la sécurité et la justice aux citoyens, prévaut un bon sens qui s’oppose à une perception globale de « l’autre ». Une compréhension adéquate des processus qui marginalisent historiquement de vastes segments de la population et qui génèrent une grande masse d’exclus, de chômeurs et de désespoirs reste encore à venir.
Un contexte comme le nôtre nécessite un effort important de la part de l’Université pour multiplier les recherches sur les droits, les différents types d’intolérance et les conceptions différentes (et parfois antagonistes) de l’humanité et de la légitimité. Le problème présente une telle complexité que seul un débat interdisciplinaire, continu, régulier et cohérent peut l'aborder de manière adéquate et produire des développements utiles dans la formulation des connaissances nécessaires pour renverser les actions despotiques et la formulation de politiques publiques, capables ainsi de contribuer à améliorer cette situation. scénario conflictuel.
Justification
La création d'un programme d'études supérieures en sciences humaines, droits et autres légitimités a permis de réunir des professeurs-chercheurs qui travaillent à l'USP dans le but de fournir aux étudiants intéressés une solide pratique du travail interdisciplinaire et une formation académique critique, qui leur permet de réaliser les activités les plus variées et pertinentes liées à leur processus de production.
Pour une compréhension adéquate de ce choc de conceptions et de pratiques associées aux droits, aux représentations humaines et à la légitimité sociale et juridique, il est nécessaire d'analyser la localisation historique des sujets dans la hiérarchie socio-économique et leurs savoirs respectifs. On ne peut ignorer que l’hégémonie de la connaissance scientifique parvient à acquérir une légitimité à travers la dévalorisation de « l’autre » et de ses expériences collectives. Donc leurs connaissances et leurs pratiques.
La base de cette proposition est la notion, largement discutée et établie de manière consensuelle, selon laquelle les connaissances et les objets de réflexion des chercheurs nécessitent une interdisciplinarité, de sorte que leurs conditions historiques découlent de décisions prises dans les domaines de la politique, de l'économie, des valeurs et pratiques socialement établies, des traditions, des organisations familiales, des clans et des environnements géographiques, entre autres. Cela soulève des développements psychiques, physiques et symboliques pertinents pour les processus historiques, cognitifs et comportementaux qui intéressent différents domaines de la connaissance, parmi lesquels, outre le domaine des sciences humaines, se distinguent les connaissances des domaines médical, comportemental et juridique.
La fragmentation des connaissances qui constituent les différentes disciplines scientifiques a permis aux processus de développement de leurs domaines respectifs de constituer des théories et des méthodes de recherche extrêmement diverses, au point de garantir des mesures détaillées de réalités spécifiques. Cette phase de développement des connaissances était d'une importance indéniable, mais il est aujourd'hui nécessaire d'utiliser des connaissances spécialisées pour intégrer à nouveau les processus de compréhension des êtres vivants - y compris la culture humaine et même la planète dans cette dimension - comme conséquence d'expériences socialement réalisées, le tout à la lumière d'une perspective holistique, à travers laquelle l'ensemble des connaissances accumulées tout au long de l'histoire des différentes civilisations peut être exploité.
Les défis de notre époque nécessitent une coopération systématique entre chercheurs de telle sorte que, appuyés par des recherches capables de communiquer entre eux, ils permettent de formuler des hypothèses prenant en compte les singularités et la pluralité des phénomènes étudiés. De multiples perspectives émergent des propositions, des diagnostics et des solutions plus adaptées aux besoins de connaissance de notre époque. Des études plus complexes permettent de trouver des solutions adaptées à des problèmes rencontrés unilatéralement, dont les réponses ne révèlent pas les liens et les chevauchements qui montrent leur complexité.
À la lumière de ces considérations, ce programme d'études supérieures a :
• quatre axes de recherche et un domaine de concentration ;
• un profil interdisciplinaire
• un noyau de conseillers permanents, ainsi que de collaborateurs occasionnels (professeurs invités/visiteurs) ;
• un accompagnement au niveau de la maîtrise et du doctorat pour les étudiants diplômés dans différents domaines du savoir ;
• des étudiants de divers horizons académiques et/ou professionnels, il s'agit du programme d'études supérieures avec le pourcentage le plus élevé d'étudiants auto-déclarés noirs, bruns et autochtones (PPI) de toute l'Université de São Paulo, en plus d'un nombre important d'étudiants trans, réfugiés et personnes handicapées ;
• des matières continuellement mises à jour et bénéficiant de la participation plurielle des enseignants, dont une matière obligatoire sur les pratiques et la recherche interdisciplinaires ;
• organisation de conférences, débats, séminaires, échanges, voyages académiques et visites techniques dans des institutions nationales et étrangères, qui complètent la formation des étudiants et renforcent le PPGHDL.
La formation de base implique nécessairement les domaines de l'histoire, du droit, de la littérature, de la linguistique, des arts, des sciences sociales, de la philosophie, de la psychologie, de l'éducation et de la communication. Ces domaines de connaissances interagissent également dans les disciplines proposées par le PPGHDL.
Dans ce programme, l'innovation est constamment recherchée, que ce soit en raison de la nécessité de renouveler les thèmes étudiés et les manières de les aborder ou parce que les questions liées à l'altérité, à la pluralité culturelle, aux droits de l'homme et à l'intolérance se manifestent de manière profondément dynamique et controversée.