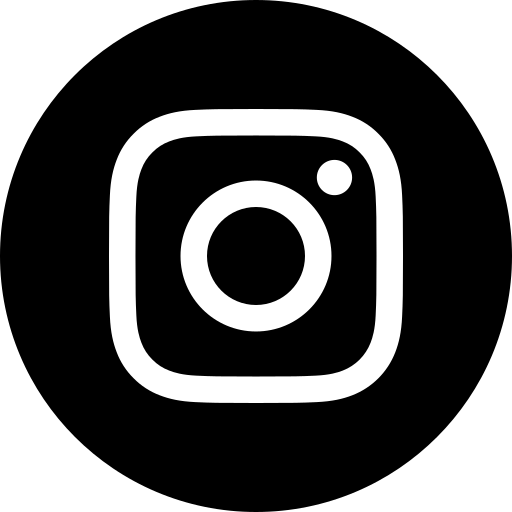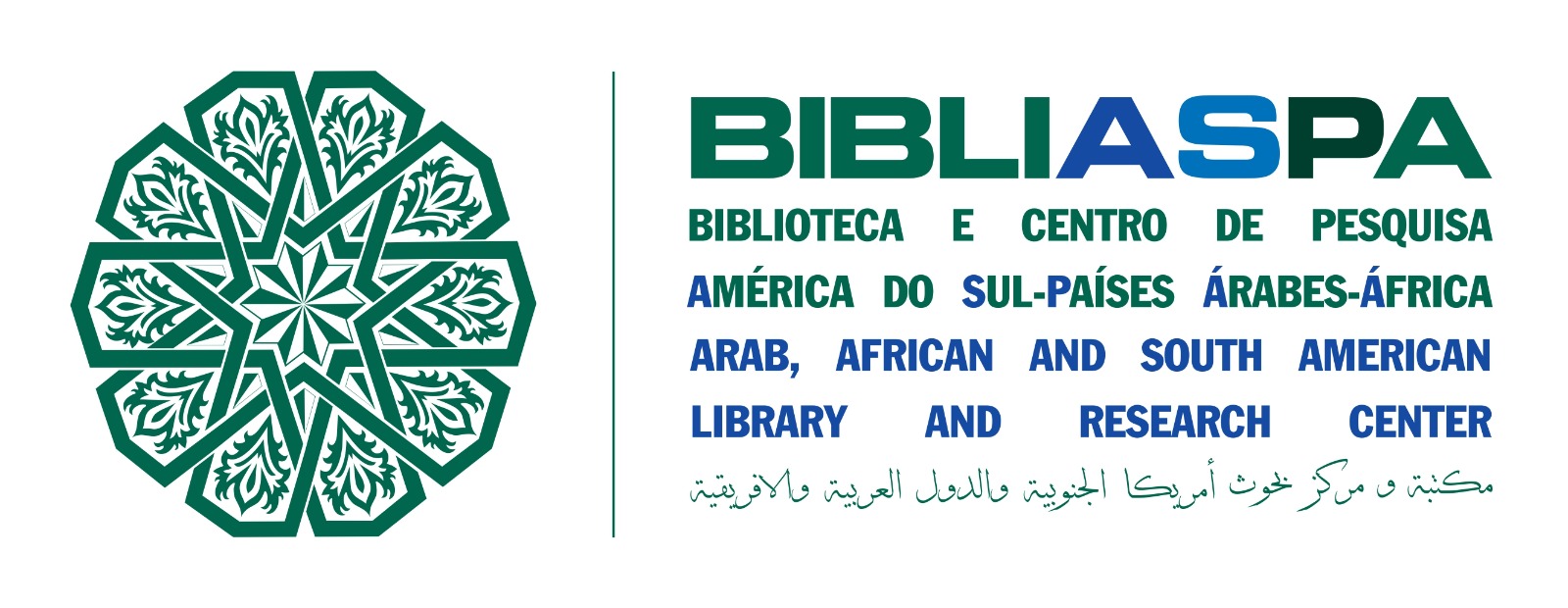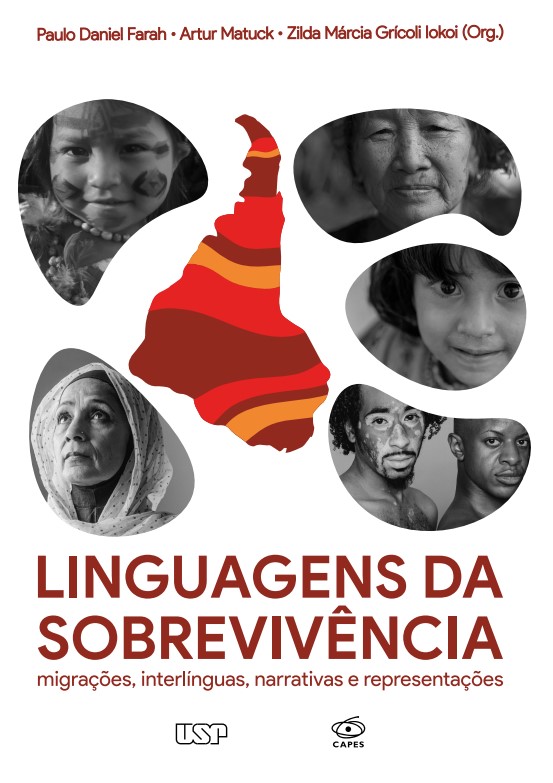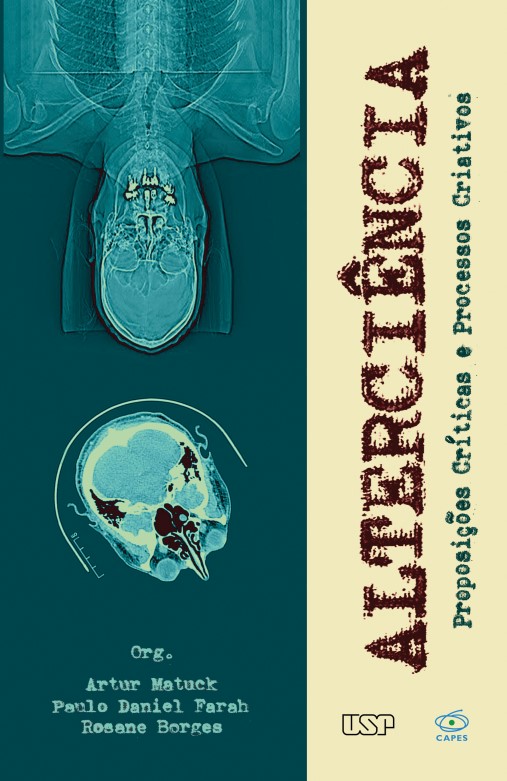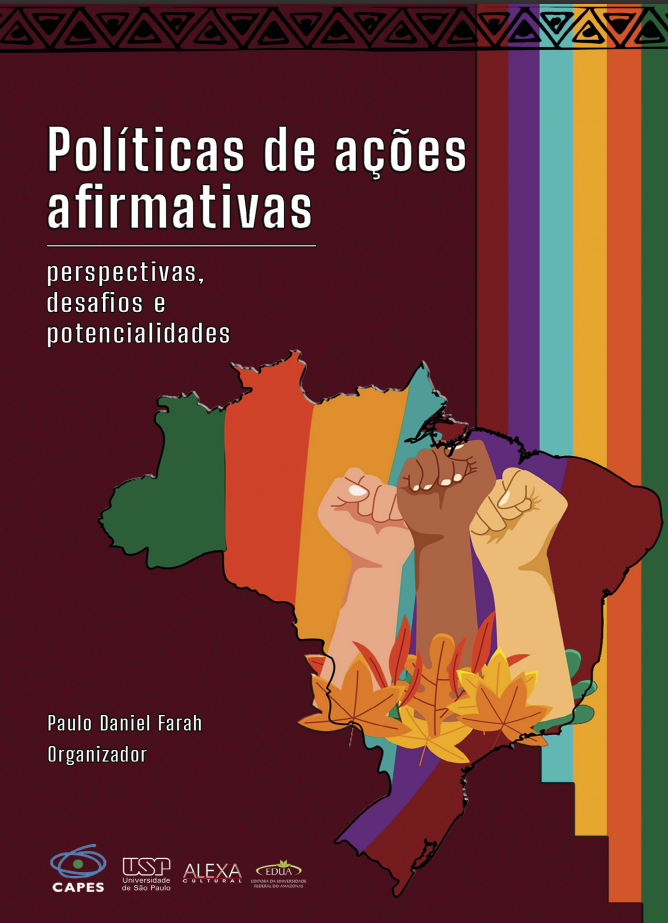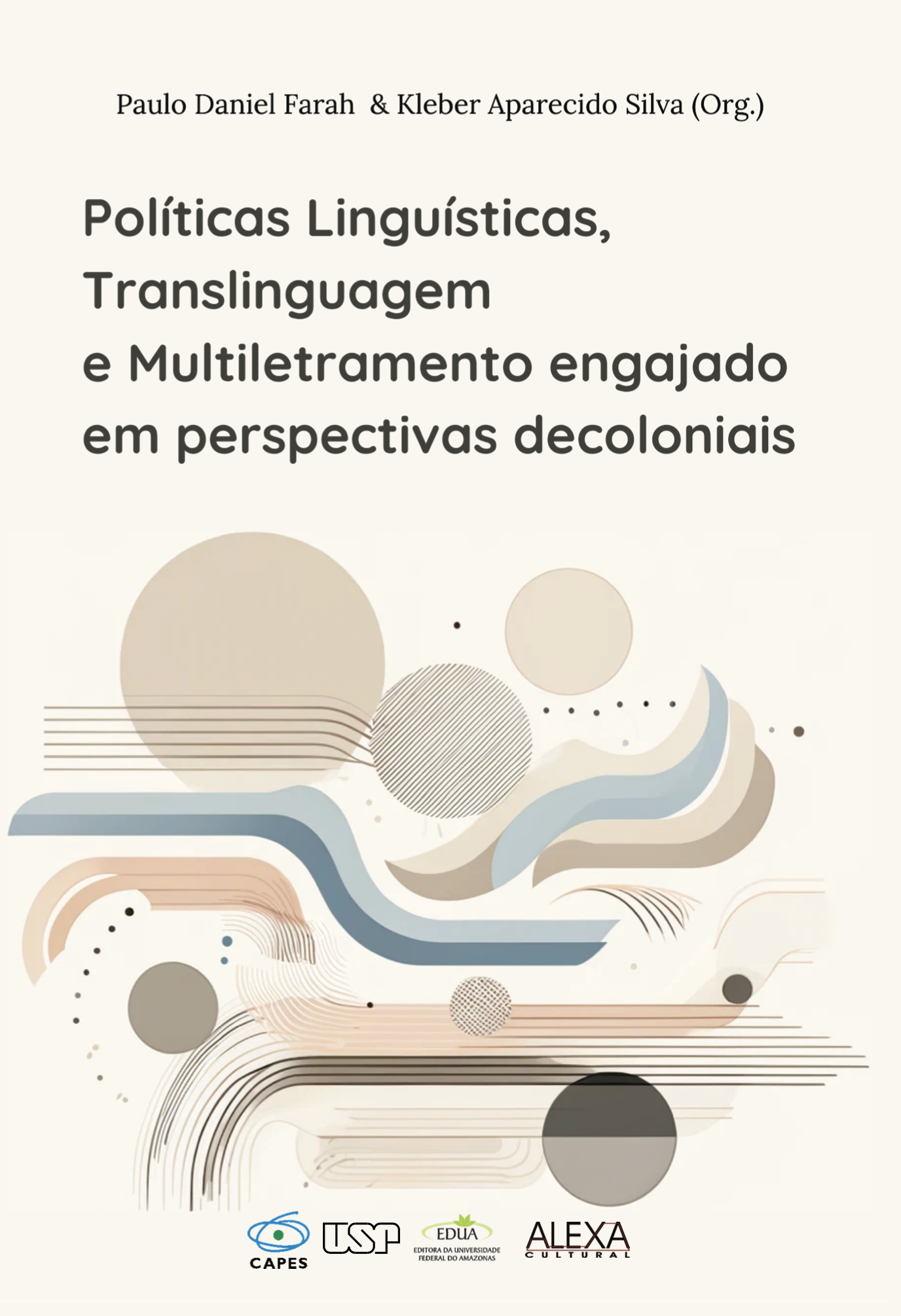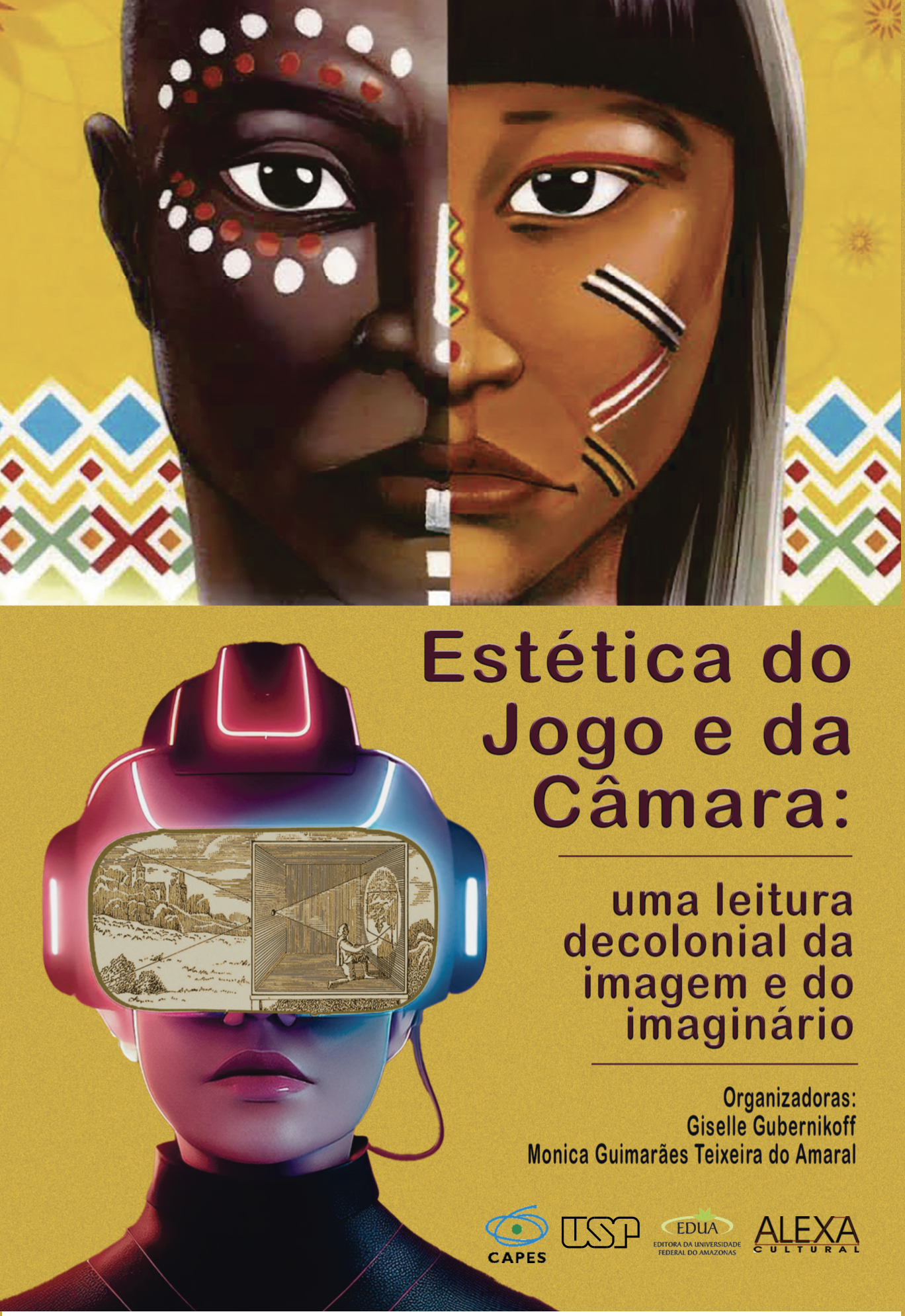Le programme de troisième cycle en sciences humaines, droits et autres légitimités de l'USP se caractérise par l'interdisciplinarité, c'est pourquoi il fait partie de l'espace interdisciplinaire de Capes et comporte une matière obligatoire appelée « Pratiques et recherche interdisciplinaires », qui aborde le sujet en profondeur et vise à offrir un espace de réflexion et d'échange de connaissances entre enseignants et étudiants du troisième cycle en sciences humaines, droits et autres légitimités, dans le but de débattre de leurs projets de recherche et de construire un champ commun de connaissances partagées. dans le domaine interdisciplinaire.
La discipline donne la priorité aux questions théoriques et méthodologiques présentées dans les recherches des enseignants et des étudiants, sans se concentrer sur un sujet spécifique. Il valorise également le dialogue interdisciplinaire sur des sujets pertinents aux savoirs des populations noires, indigènes, quilombolas, riveraines, immigrés, réfugiés, africains, personnes handicapées, trans, non binaires et LGBTQIAP+, perspective de genre, urbaine, rurale et périphérique. domaines, afin qu'ils soient entendus et que leurs récits, connaissances, thèmes, expériences et expériences d'oppression et de violences diverses (épistémiques, physiques, psychologiques) ainsi que de résistance, d'autonomie et d'autonomisation. L’objectif est que ces connaissances soient intégrées par l’université et également valorisées dans les espaces extra-académiques.
IMPORTANT!
Il est obligatoire que tous les mémoires de maîtrise et toutes les thèses de doctorat incluent le mot INTERDISCIPLINARITÉ comme l'un des mots-clés après le résumé du mémoire/thèse. De plus, il faut insérer l'expression « Dans une perspective interdisciplinaire, cette recherche rassemble des domaines de connaissances tels que X, Y et Z… » (explicitant quels domaines de connaissances ont été mobilisés) ou « Par une approche interdisciplinaire, cette recherche rassemble différents domaines de connaissances, tels que Le PPGHDL est un programme interdisciplinaire, il est donc essentiel de justifier pourquoi la recherche a été développée dans ce programme de troisième cycle, qui défend l'interdisciplinarité et comporte une matière obligatoire sur la manière de développer la recherche de manière interdisciplinaire.
Outre la réflexion sur la structure et le fonctionnement du Programme, il convient de réfléchir à la pertinence de l’interdisciplinarité. L'interdisciplinarité et la transdisciplinarité visent à élargir la compréhension des phénomènes, au-delà des divisions cloisonnées, et à une reconfiguration des perspectives, des répertoires et des secteurs de la réalité.
Cette articulation, outre une manière de mener la recherche de manière intégrée, en vue d'atteindre les objectifs affichés, implique, en elle-même, un déplacement des divisions disciplinaires les plus canoniques des connaissances et des ressources théorico-pratiques mobilisées au sein des contours disciplinaires, tel qu’établi par le paradigme occidental.
L'interdisciplinarité et la transdisciplinarité apparaissent comme une manière de briser les lignes de démarcation des disciplines, avec leurs propres méthodes et lignes directrices, qu'il faut briser et reconstruire, voire dépasser.
Dans ce domaine frontalier entre différents domaines de la connaissance, il est possible de construire de nouvelles façons d'être et d'agir. Et c’est seulement à ce moment qu’une nouvelle épistémè commence à émerger, un savoir anticolonial transdisciplinaire.
La production de connaissances à l’époque contemporaine nécessite une forme radicale d’interdisciplinarité, comme le souligne l’historien burkinabé Joseph Ki-Zerbo. Dans Histoire générale de l’Afrique, Ki-Zerbo soutient que l’interdisciplinarité devrait conduire à un projet interdisciplinaire, et qu’aucune discipline ne bénéficie d’une approche unique de la réalité dense et enchevêtrée du continent africain. Selon l’auteur, les sources de l’histoire africaine, par exemple, sont clairement complémentaires ; Chacun d’eux, isolé, ne transmet qu’une image imprécise de la réalité, que l’intervention d’autres sources – issues de différents domaines de la connaissance – peut contribuer à définir.
L'UNESCO discute de l'interdisciplinarité depuis 1981. « Lors du colloque de 1981 (UNESCO, 1983), les participants se sont d'abord préoccupés des conditions et des conséquences épistémologiques de l'interdisciplinarité : bon nombre de travaux s'attachent à proposer des définitions rigoureuses en ce sens. Lors du colloque de 1991 (PORTELLA, 1992), les chercheurs réunis (plus nombreux que lors de la manifestation précédente) ont concentré leur attention sur la construction d'un projet opérationnel et pratique d'interdisciplinarité et sur sa reconnaissance par le monde institutionnel de la recherche, comme s'il s'agissait de questions épistémologiques. étaient résolus ou comme si l’événement, dix ans plus tard, était moins de nature scientifique que de nature organisationnelle et institutionnelle » (PORTELLA, 1992 Apud : TEIXEIRA, 2004).
Comme le souligne le document de CAPES 2019 pour les programmes interdisciplinaires, en pages. 12 et 13 :
« L'interdisciplinarité se caractérise comme un espace privilégié, en raison de son caractère transversal propre, indiqué dans son préfixe, pour avancer au-delà des limites disciplinaires, en articulant, en transposant et en générant des concepts, des théories et des méthodes, en dépassant les limites de la connaissance disciplinaire et en s'en distinguant, en établissant des ponts entre différents niveaux de réalité, logiques et formes de production de connaissances. Pour cela, un dialogue fréquent entre ses sous-domaines et d’autres domaines disciplinaires est essentiel.
L'adoption de ces principes dans la formation des ressources humaines à travers les pratiques de recherche, d'enseignement et de vulgarisation présente plusieurs défis pour les enseignants et les étudiants du Domaine Interdisciplinaire, parmi lesquels se distinguent les suivants :
• Promouvoir l'ouverture face aux nouvelles perspectives théorico-méthodologiques dans la recherche, l'enseignement et l'innovation;
• Aborder les défis épistémologiques que l'innovation théorique et méthodologique présente à la recherche et à l'enseignement interdisciplinaires, qui nécessitent des dialogues de plus en plus étroits entre les disciplines de différents domaines de la connaissance et entre les domaines, ainsi qu'avec les philosophies de la science, dans ses différents aspects;
• Promouvoir l'intégration de méthodologies interdisciplinaires dans les projets de recherche des enseignants et des étudiants;
• Reconnaître que dans la recherche et l'enseignement interdisciplinaires, différents concepts peuvent être adoptés, car il est possible de construire des significations différentes, en valorisant et en reconnaissant la diversité qu'implique le domaine;
• Approfondir les caractéristiques déterminantes des concepts de pluri, multi et interdisciplinarité, leurs différents contextes théorico-méthodologiques, en tenant compte de leurs relations et différenciations, possibilités et limites, afin de mieux soutenir les définitions des propositions d'enseignement et de recherche, leurs lignes innovantes. , ainsi que les évaluations des différents programmes du Domaine interdisciplinaire;
• Identifier des canaux pour intensifier le dialogue entre et au sein des chambres thématiques du domaine interdisciplinaire, pour l'échange d'expériences entre les programmes et la diffusion des connaissances interdisciplinaires générées.
Compte tenu du fait que l'un des plus grands défis de ce siècle est la (re)connexion des connaissances, dans l'Espace Interdisciplinaire, un espace est ouvert pour l'innovation dans l'organisation de l'enseignement postuniversitaire et de la recherche, un espace qui induit une formation interdisciplinaire et une perspective humaniste. d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs. Cette formation se concentre sur le développement et l'adoption d'une attitude interdisciplinaire dans ses différentes pratiques d'enseignement, de recherche et de vulgarisation, y compris la nécessaire insertion sociale de la production scientifique et technologique générée.